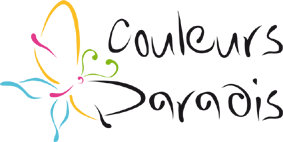Comment se déroule une fouille préventive ? Le cas du site amérindien du port de Basse-Terre en Guadeloupe
le déroulement des travaux sur le terrain
Dans le cadre d’un projet de construction d'immeuble dans le port de Basse-Terre - Guadeloupe, une fouille a permis de découvrir des restes amérindiens exceptionnels, antérieurs à la période coloniale. Un documentaire réalisé par la direction régionale des affaires culturelles de Guadeloupe, en collaboration avec les archéologues de l’institut national de recherche archéologique préventive - INRAP, présente les étapes qui ont conduit les archéologues à entreprendre la fouille du site amérindien découvert sur le port de Basse-Terre.
Une chronologie particulière
En Guadeloupe, l’archéologie est soit « précolombienne », soit « coloniale ». La période précolombienne, c'est à dire antérieure à l’arrivée de Christophe Colomb en 1492, correspond en quelque sorte à la préhistoire de la Guadeloupe. On ignore encore exactement quand sont arrivés les premiers amérindiens en Guadeloupe. Les plus anciennes traces connues (époque précéramique) datent de 1500 av. J.-C.
Les groupes connaissant la céramique sont mieux connus : ils apparaissent vers 400 av. J.-C. C’est à Basse-Terre qu’ont été trouvés et fouillés les sites les plus importants de cette période appelée « huécoïde » (ou « encore huecan-saladoïde »). La fouille du port autonome de Basse-Terre correspond à un site huécoïde assez récent puisque remontant aux environs de 200 apr. J.-C.
Les groupes saladoïdes apparaissent vers le début de notre ère et leurs successeurs (« post-saladoïdes ») étaient encore présents lorsque les premiers colons arrivèrent au début du XVIIe siècle. Ces derniers entrèrent en contact avec les « indiens » indigènes qui furent ensuite décimés très rapidement.
 Un important site huécoïde découvert à Basse-Terre
Un important site huécoïde découvert à Basse-Terre
Le début de la période coloniale est marqué par la construction du bourg de Basse-Terre dès 1635. A l’occasion d’un projet de construction du Port Autonome de Guadeloupe, les historiens et les archéologues ont progressé dans la connaissance de la ville. Les archives mentionnant la présence de vestiges du XVIIIe siècle à l’emplacement du projet, la direction régionale des affaires culturelles a décidé la réalisation d’un diagnostic archéologique à cet emplacement. Les premiers sondages ont permis de retrouver quelques aménagements coloniaux, mais c’est la découverte inattendue d’un important site huécoïde qui a conduit les archéologues à entreprendre, avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) la fouille du site. Celle-ci a été financée par le Port Autonome de Guadeloupe.
Un DVD didactique et pédagogique
Un film documentaire a été élaboré par la direction régionale des affaires culturelles de Guadeloupe/service régional de l’archéologie, en collaboration avec les archéologues de l’INRAP, pour présenter les diverses étapes qui ont conduit les archéologues à entreprendre la fouille du site amérindien découvert sur le port de Basse-Terre. Ce film retrace également le fonctionnement général du chantier archéologique, le déroulement des travaux sur le terrain avec, en particulier, la fouille d’une sépulture, ainsi que les études conduites sur la céramique et les divers travaux menés après la fouille pour placer en perspective les découvertes et permettre de les restituer au public. Ce film est diffusé par le Centre régional de documentation pédagogique.
Une information déjà ancienne mais toujours d'actualité, du site www.culture.fr